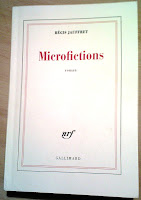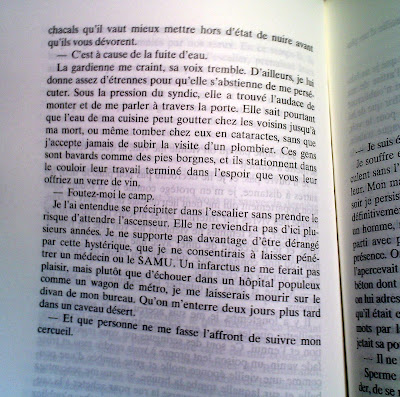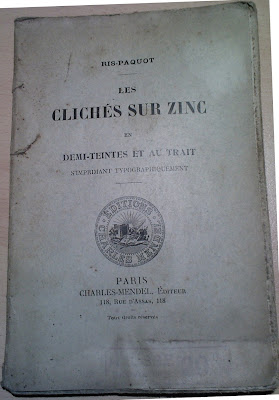Des journées limpides. La sustentation des aérosols venait parfois perturber le ciel acier, normalisant le grisâtre perceptible de ce plafond toujours trop bas pour moi. Depuis tout petit, j’avais compris qu’un jour le ciel finirait par me tomber sur la tête. Moi le premier bien entendu. J’étais sensible à ce décor envahissant qui meublait notre quotidien. Autour de moi tout semblait confondre ce soupçon. La vie humaine n’avait aucune valeur-, on écrasait, tuait, broyait, bombardait, pulvérisait, éclatait sans condition mes semblables. J’étais épargné, je n’épargnais pas, mais je m’épargnais.
J’étais conscient de mon centrisme sans parallèle, de ma longue vue à courte portée nombriliste. Mon regard s’escrimait à ne jamais dépasser le bout de mon nez : je ne voyais aucun intérêt à aller plus loin. L’autre est différent, autant se connaitre soi-même, essentiellement soi-même. Je n’ai jamais vraiment fini de m’étonner. Je suis mon sujet d’étude, je suis mon étalon, je suis à ma mesure. Certes, d’autres pourront dire que je perturbe mon analyse : étant tour à tour sujet d’expérience, puis outil de mesure, puis analyste. Je dessine avant tout les pôles distendus de mon infini personnel. J’en suis arrivé à me qualifier d’extrapôlateur, néologisme de mon cru à l’origine de ma totale compréhension de moi-même. L’extrapôlateur pouvant être défini de manière extrêmement synthétique par son écriture. Ecrit régit par la constations suivante : est parfaitement compréhensible pour l’extrapôlateur ce qui ne l’est pas pour vous…
Je ne suis pas un éternel retour à moi : je me confronte viscéralement à moi-même. Je suis en constante opposition personnel, opposition qui m’amène souvent à ne plus vraiment me reconnaitre. Je suis multiple en moi-même. Je m’étouffe de mon sujet, mais j’en éprouve un certain plaisir. J’irais jusqu’à parler d’une jouissance s’approchant de la sensation d’asphyxie physique que j’éprouve alors que je force sur le siège de ma conscience. J’habite au fond de moi-même. Autant dire tout près de moi.
J’ai les yeux clos et je sens tes allez-venus, petit à petit vos allez-venus. Vous bruissez en moi. J’ai les yeux ouverts et mon horizon sait pourtant ne pas être perturbé. Je suis seul face à un continuum lointain, tendu, comme un rideau de théâtre. J’imagine des marionnettes sur fond de perceptions cérébrales. Je pense à Dorian Gray et je me dis, qu’après tout, son tableau n’était vraiment pas terminé. Moi, j’aurais été au paroxysme d’une vie d’éternité, mon autoportrait tendrait vers une perfection ultime : il ne peut-être que le chef d’œuvre absolu.
Digression mise à part, je vous sens bruire autour de moi, vous n’avez rien du règne végétal, vous vous mêlez au froissement minéral de papiers que l’on plie, ou que l’on range dans de petites enveloppes. Je vois vos pas comptés comme les miens dans cet espace clos. J’ai pris appuis sur le vieux pupitre collégien et j’essaye un Bic, machinalement, sur le bois, usé. J’écris : eXtrApÔlAteUr, je graphitite, je gribouille, je m’escrime au sabre Bic. J’entends un toussotement léger, j’ai de l’encre sur les doigts, une encre gluante, morte. Je m’entends toussoter. Un toussotement semblable à celui que j’ai initialement entendu. Autour de moi, derrière, le rideau bleu ondulé, froissé : je vois écris, sur le bois scolaire, extrapôlateur. J’ai la sensation d’avoir une écharde sur le tranchant de la main gauche. J’ai fait tomber des feuillets.
Je ne m’ennuie pas dans mon isoloir : je suis chez moi. Je ferme les yeux. Je les rouvre subitement et les referme immédiatement, c’est un peu comme la mer à perte de vue, ce tissu bleu roi. J’ai toujours imaginé mon esprit comme un océan sans bord et mes pensées comme des colorants, mes sensations comme des oscillations qu’on appelle vagues. Les crêtes d’écumes et les vents sont mon appétit marin. Je vacille un peu et je m’appuie sur les rideaux qui s’effondrent devant moi. Je m’étale de tout mon long dans la salle bondée. C’est vraiment subit.
Il est midi quarante, c’est là où s’accroche mon regard désespéré. Les aiguilles sont au-dessus d’une des urnes qui ne sont plus le sujet d’intérêt de l’endroit. Je prends le premier petit papier à ma portée. Je lis : José Bové. Je remarque que les fentes ténues de la boite sont munies de mâchoires. Je n’avais pas bien regardé, je trouve ça triste. J’ai le temps de me dire que les urnes françaises n’incitent pas au vote. Le silence se fait pesant, même pas une musique officielle, une petite marseillaise revigorante, une bourrée bien de chez nous, un air en trainant. Rien que ces boites alignées, ternes, non transparentes. J’imaginais, maintenant, devant moi des boites pleines de la magie électronique : façade plasma tactile avec la tête des candidats, leurs différents sourires de démarcheurs de cinémas, qui défilent, leurs rictus sauvage de futur vainqueurs pour cinq ans. Et de grandes flèches brillantes pointant vers la bouche tirée, rigide, inexpressive.
Je me vois alors crier : « Voilà ce que c’est que de voter : ça vous fait tomber à la renverse ». Les regards croisent à mon endroit. Je suis sur le dos comme une tortue, les quatre membres en l’air. Mon rire mal à l’aise. Je roule un peu sur le coté. Mon rire mal à l’aise. Je pointe mon postérieur et j’appuie sur le sol avec mes deux mains. Je me redresse. Je sens qu’on m’aide à relever. J’ai des ailes dans le dos. Mon rire mal à l’aise. (« Merci, ça va »). Je reprends ma respiration. Je brandis le petit bout de papier, enfin le seul qui ne s’est pas échappé dans ma chute. Et je crie sans gêne, j’ai respiré juste avant : « C’est pour lui que je vote ». José Bové… Pas mal comme choix : il va faire un bon score ici (il y a déjà moi qui vote). J’agite le bulletin. Les votants sont myopes ?
Je me dirige vers l’urne fermement. Derrière l’urne une française aussi terne que l’urne. Un serre-tête, une robe à smoke, je dirais plutôt le genre sac Tati les jambes ternit par des bas grisâtres et de l’or fade aux poignets aux oreilles sur le poitrail. « A voté » comme à la messe, républicaine : c’est pas certain. En tous cas je dénote une véritable symbiose entre l’urne et la manipulatrice.Personne n’a l’audace de m’interrompre. José Bové est dans l’urne et dans mon dos alors que je quitte la salle.
Dimanche de vote. Je me suis trouvé très bon.